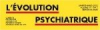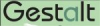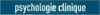|
Résumé :
|
Objectif : L’auteur de cet article se propose d’examiner la genèse de la paraphrénie chez Joseph Guislain. Il s’attache ainsi à remédier à l’absence d’étude détaillée de cette catégorie aux origines francophones méconnues. Cette catégorie s’avère en effet traditionnellement rattachée à la psychiatrie de langue allemande (Kahlbaum, Kraepelin). Méthode : Cette étude s’appuie sur l’analyse textuelle des deux premiers ouvrages de Joseph Guislain : d’une part, le Traité sur les aliénations mentales (1826) et, d’autre part, le Traité sur les phrénopathies (1833) dans lequel apparaît pour la première fois la paraphrénie. Résultats : Cette analyse nous a permis de montrer que la paraphrénie constitue une véritable catégorie clinique, au statut nosographique bien défini, depuis 1833. Malgré ses multiples dénominations synonymiques (folie, réaction fantastique notamment), Guislain développe une conception homogène de la paraphrénie assimilée à une réaction morale. Cette analyse nous a également permis de recenser ses caractéristiques sémiologiques et formelles. Guislain décrit dix espèces d’impulsions bizarres fréquentes et régulières constitutives de la forme simple de la paraphrénie. Il cartographie également ses formes complexes. Enfin, nous avons pu constater le pessimisme de Guislain sur son évolution, qu’il estime généralement funeste.Discussion: La catégorie de paraphrénie a connu un début de diffusion contrasté durant la fin de la première moitié du XIXe siècle. En effet, sa réception dans la psychiatrie de langue allemande fut marquée et facilitée par la publication rapide, en 1838, de deux traductions du Traité sur les phrénopathies (1833) tandis qu’elle se diffusa avec peine dans la psychiatrie francophone.Conclusions : La paraphrénie constitue chez Guislain une double invention, d’une part terminologique et d’autre part nosographique, dont l’aliéniste belge a donné des descriptions sémiologiques nombreuses et développées. [résumé d'auteur]
|







 Je m’abonne
Je m’abonne Je consulte
Je consulte